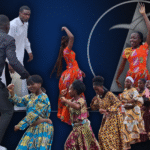Evangile selon Saint Luc 10,25-37:
): Pour mettre Jésus à l’épreuve, un docteur de la Loi lui posa cette question: « Maître, que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle?». Jésus lui demanda: «Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit? Que lis-tu?». L’autre répondit: «Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même». Jésus lui dit: «Tu as bien répondu. Fais ainsi et tu auras la vie».
Mais lui, voulant montrer qu’il était un homme juste, dit à Jésus: «Et qui donc est mon prochain?». Jésus reprit: «Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits; ceux-ci, après l’avoir dépouillé, roué de coups, s’en allèrent en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin; il le vit et passa de l’autre côté. De même un lévite arriva à cet endroit; il le vit et passa de l’autre côté. Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui; il le vit et fut saisi de pitié. Il s’approcha, pansa ses plaies en y versant de l’huile et du vin; puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui disant: ‘Prends soin de lui; tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai’.
»Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme qui était tombé entre les mains des bandits?». Le docteur de la Loi répond: «Celui qui a fait preuve de bonté envers lui». Jésus lui dit: «Va, et toi aussi fais de même».
Vin, huile, deux deniers et un âne-ambulance
Luis CASASUS Président des Missionnaires Identès
Rome, 13 juillet 2025 | XVe dimanche du temps ordinaire
Dt 30, 10-14 ; Col 1, 15-20 ; Lc 10, 25-37
En 2020, pendant la pandémie, un boulanger sicilien nommé Vincenzo donnait chaque matin du pain à ceux qui ne pouvaient pas se le payer. Pour cela, il accrochait des sacs de pain à la porte de sa boulangerie avec une affiche qui disait : Que ceux qui le peuvent laissent quelque chose. Que ceux qui ne peuvent pas prennent ce dont ils ont besoin. Son geste a inspiré d’autres commerçants à faire de même.
C’est émouvant et intéressant, car sa bonne action s’adressait à toute personne dans le besoin, sans qu’il ait la possibilité de voir qui en bénéficiait, et probablement sans que ces personnes aient l’occasion de le remercier, ne serait-ce d’un regard.
Dieu merci, il existe d’innombrables cas similaires, qui s’inscrivent dans la lignée de ce que le Christ nous enseigne dans la parabole du bon Samaritain : Mon prochain, c’est simplement quelqu’un qui a besoin de mon aide. Une autre question est de savoir si je suis prêt à le regarder, comment je vais l’aider, ce que je vais laisser pour plus tard afin de l’aider…
D’un point de vue purement psychologique, l’exemple du boulanger illustre ce que certains spécialistes appellent « l’effet domino de la compassion » : lorsque nous sommes témoins d’un acte de générosité, cela déclenche en nous une disposition à le reproduire.
Mais ce que le Christ nous enseigne aujourd’hui à la fin de la parabole est bien plus important : cette miséricorde a pour réponse l’héritage de la vie éternelle, c’est pourquoi Jésus dit au savant de la Loi (et à vous, et à moi) : Va, et fais de même.
—ooOoo—
Pour comprendre en profondeur ce que Jésus veut transmettre dans l’histoire du Bon Samaritain, il est intéressant de savoir ce que signifiait cette scène à l’époque et ce qui peut nous rendre semblables au lévite et au prêtre qui sont passés sans s’arrêter.
À cette époque, les routes étaient pleines de prêtres et de lévites qui allaient et venaient de Jérusalem. Zacharie lui-même était l’un de ces prêtres. Ils travaillaient selon un horaire établi par le roi David. Ils quittaient leur travail quotidien pendant deux semaines par an et servaient dans le Temple. Un lévite n’était pas un prêtre, mais il servait dans le Temple. La route de Jérusalem à Jéricho était particulièrement connue sous le nom de « chemin du sang », car elle était difficile à emprunter et propice aux agressions.
Le prêtre et le lévite ne se sont pas occupés de l’homme blessé, probablement parce qu’ils étaient terrifiés. Peut-être que les voleurs étaient encore dans les parages et qu’ils risquaient de subir le même sort que la victime, ou peut-être que l’homme blessé faisait seulement semblant et que certains de ses complices attendaient que quelqu’un tombe dans le piège. Ils se sont demandé ce qui pourrait leur arriver s’ils s’arrêtaient, mais le Samaritain a donné la priorité au blessé, sans se soucier de ce qui pourrait lui arriver.
Le lévite et le prêtre ont certainement prié pour le pauvre malheureux et lui ont souhaité bonne chance dans leur cœur. Est-ce suffisant ? Ce n’est certainement pas mal. Mais c’est une chose de souhaiter bon voyage à quelqu’un, c’en est une autre de lui offrir une bonne carte… et encore une autre de l’accompagner pendant une partie du voyage.
Lors du célèbre naufrage du Titanic en 1912, certains passagers de première classe ont utilisé leur statut ou leur force pour s’assurer une place dans les canots de sauvetage, malgré le code non écrit « les femmes et les enfants d’abord ».
L’un des cas les plus commentés fut celui du président de la compagnie propriétaire du Titanic. Il survécut en montant dans un canot alors que des centaines de femmes et d’enfants attendaient encore. Ses deux assistants s’accrochèrent à une planche flottante et moururent peu après. Ce fut un acte d’égoïsme lâche, et non un dilemme éthique complexe.
Ce type de comportement ne soulève pas de grande question morale : il ne s’agissait pas de choisir entre deux biens ou deux maux, mais de faire passer son propre bien-être avant la souffrance d’autrui. C’est un exemple cru de la façon dont l’instinct de bonheur, qui se manifeste ici sous forme d’instinct de conservation, peut éclipser la compassion.
Il n’est pas nécessaire de penser à des situations dramatiques comme celle du Titanic. Un geste pour aider toute personne en difficulté suffit. La raison, mentionnée précédemment, est que la miséricorde « à la manière du Samaritain » ne permet pas seulement de vivre la vie éternelle, mais elle la transmet, la communique.
Dans la vie de Jésus, il y a un moment particulièrement significatif, lors des noces de Cana, où il soumet les plans qu’il avait pour commencer sa vie publique à la miséricorde manifestée par sa mère, qui a remarqué le contretemps des mariés qui se sont retrouvés sans vin. Rien n’était plus important que ce geste imprévu, cette aide dans une situation qui n’était pas une question de vie ou de mort.
L’excuse qui a le plus de poids, synthèse et conclusion de toutes ls autres excuses que nous invoquons pour agir comme le prêtre et le lévite, est : Ce n’est pas à moi d’aider. Je peux la fonder sur mon manque de compétence, sur l’importance supposée de ce que je suis en train de faire, sur ma propre hâte et mon impatience, sur la crainte de contempler la souffrance de mon prochain… En tout cas, celui qui ne vit pas la miséricorde ne peut être heureux, car, comme le conclut la première lecture : Le commandement est tout près de toi, dans ton cœur et dans ta bouche, afin que tu le mettes en pratique.
Cette loi ne peut être une chose impossible, quelque chose d’écrit en nous pour nous faire souffrir. Il est toujours possible de faire quelque chose pour montrer notre volonté d’aider. Comme l’illustre la parabole du Bon Samaritain, et comme le savait très bien le docteur Luc, le vin peut servir de désinfectant et l’huile de sédatif d’urgence pour soulager la douleur.
La question du maître de la Loi « Qui est mon prochain ? » avait peut-être pour but de mettre le Christ dans l’embarras, mais elle révèle sans aucun doute une inquiétude intérieure, un remords de ne pas être allé plus loin que l’amour attendu de quelqu’un qui obéit à la Loi écrite dans la Torah. Celui qui n’a pas fait l’expérience de mourir à lui-même, d’abandonner son confort, ne peut pas connaître la joie pleine du Christ.
—ooOoo—
Cette parabole illustre avec une intensité particulière le fait que la véritable miséricorde, l’extase la plus pure, implique toujours de laisser derrière soi quelque chose d’important. Sans aucun doute, le bon Samaritain n’a pas pu prévenir de son retard, ce qui allait lui causer des complications. Un autre détail significatif est le fait que la victime avait été dépouillée de ses vêtements, ce qui obligeait le Samaritain à déchirer ses propres vêtements pour le bander.
Gardons à l’esprit un fait important concernant le peuple samaritain, tant détesté, auquel appartient le protagoniste. Dans le chapitre 9 de l’Évangile selon saint Luc, nous venons de lire que Jésus n’a pas été accueilli dans un village samaritain, car il était un pèlerin en route vers Jérusalem. Cela éclaire encore davantage l’enseignement selon lequel n’importe qui, « même un Samaritain », peut faire preuve d’une générosité extrême, ce qui devrait nous pousser à inviter tout le monde à faire le bien, certains que la loi de la miséricorde est écrite dans leur cœur et… finira par s’imposer. Avant de raconter cette parabole, le Christ avait tenu compte de cette réalité en appelant des pêcheurs sans valeur particulière et en envoyant devant lui 72 disciples peu formés et, sans doute, avec des personnalités difficiles.
Je voudrais raconter une expérience personnelle avec une personne « samaritaine », dont je garde un souvenir affectueux et reconnaissant.
Appelons-le Manuel. Il était éloigné de l’Église, non par conviction, mais parce que personne ne lui avait donné un témoignage vraiment attrayant. C’était un ami de mon père, avec qui il allait souvent chasser la perdrix le dimanche. Il aimait beaucoup la nature et la musique, et il avait remarqué que, à l’âge de 12 ans, j’étais passionné par les animaux de toutes sortes, que j’aimais observer avec une curiosité enfantine.
Un de ces dimanches de chasse, il trouva un corbeau blessé, un oiseau de bonne taille, qui avait une aile cassée. Il le ramassa avec précaution et l’apporta à la maison pour me l’offrir, sachant que j’adorerais l’avoir comme animal de compagnie. Ce fut un remarquable succès diplomatique de sa part de convaincre ma mère, qui n’éprouvait aucune attirance particulière pour cette créature.
Heureusement, nous avions un petit jardin où Hipacio (c’est le nom que nous lui avons donné) pouvait se percher parmi les feuilles d’une vigne. À la surprise des voisins, Hipacio s’habitua à nos soins et à manger d’énormes quantités de viande de cheval (… heureusement qu’elle était très bon marché), ce qui lui permit de se remettre peu à peu. Je me promenais fièrement avec lui sur mes épaules, faisant l’envie des garçons du quartier, qui commencèrent à contribuer à son alimentation. Je me souviens avoir lu L’Île au trésor, de Robert Louis Stevenson, et avoir voulu imiter le personnage principal, le pirate Long John Silver, qui avait un perroquet sur l’épaule. Un corbeau n’était pas aussi coloré, mais tout aussi original.
Manuel s’intéressait à la santé de Hipacio, au point d’appeler un vétérinaire de ses amis pour qu’il lui prodigue quelques soins. Il s’est ainsi complètement rétabli. Ses cris n’étaient pas vraiment harmonieux, mais je pense qu’ils exprimaient sa gratitude envers ma mère patiente, mon père surpris et mes voisins émerveillés. Il a vécu plusieurs mois avec nous, puis un beau jour, il a disparu, sûrement guéri.
Ce n’est qu’une petite anecdote, un geste de Manuel pour rendre heureux un enfant qui n’oubliera jamais cette belle surprise faite par quelqu’un qui a saisi l’opportunité de lui montrer son affection.
Depuis lors, je suis convaincu que Manuel (… et Hipacio) me regardent du ciel. Je garde dans mon cœur le souvenir de ces moments. Cela m’incite à faire une pause sur le chemin et à regarder de plus près la vie de mon prochain.
______________________________
Dans les Cœurs Sacrés de Jésus, Marie et Joseph,
Luis CASASUS
Président